L'affaire de l'incarcération d’un employé consulaire algérien en France et la riposte algérienne par l’expulsion de 12 employés de la mission diplomatique française suscitent de nombreuses interrogations quant à la légalité des procédures.
Dans un entretien accordé au journal El Khabar, Saad Beghidja, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre actuel de la Commission des affaires juridiques à l'Assemblée Populaire Nationale, propose une lecture juridique des mesures prises par la justice française contre un employé du consulat algérien en France, en soulignant les dysfonctionnements de cette procédure, au regard de la réaction algérienne.
Pour mieux comprendre la situation : la France a traité l’employé consulaire selon ses lois nationales, alors qu’il existe des conventions qui régissent le statut de ces cadres en cas de soupçons ou de poursuites engagées contre eux. Comment expliquez-vous cela ?
D’un point de vue juridique, avant de juger si les mesures prises contre cet employé de la mission algérienne sont légales ou non, il est indispensable de connaître sa qualité, ses fonctions et la nature de l’acte qu’il aurait commis. En effet, les employés d’une ambassade ou d’un consulat bénéficient d’une immunité fonctionnelle partielle durant l’exercice de leurs fonctions. La Convention de Vienne de 1961 traite de l’immunité diplomatique relative à l’ambassadeur, à l’ambassade, aux biens et aux moyens de communication. En revanche, la Convention de Vienne de 1963 concerne le travail consulaire, c’est-à-dire le consul, ses assistants et les employés du consulat, et leur accorde une immunité fonctionnelle.
Que signifie l’immunité fonctionnelle ?
Cela signifie que les actes accomplis par le consul, ses assistants et les employés du consulat, dans l’exercice de leurs fonctions administratives et consulaires, au nom de l’État qu’ils représentent ou à l’occasion de leurs missions, ne peuvent faire l’objet d’arrestation, d’enquête ou de poursuites par l’État hôte. Il est donc nécessaire de distinguer entre la personne, sa fonction, et l’acte qui lui est reproché.
Je comprends à travers vos propos que, si la version française des faits venait à être confirmée et avérée, il serait alors possible de poursuivre l’employé consulaire, notamment si les faits supposés ne relèvent pas des fonctions officielles pour lesquelles il a été envoyé ?
Même si l’acte est étranger à ses fonctions officielles, les usages diplomatiques imposent à la France de déclarer l’employé comme persona non grata et de l’expulser de son territoire, à l’image de ce qu’a fait l’Algérie. D’autant plus que l’acte évoqué dans les médias n’a pas été commis, et qu’aucune preuve irréfutable ne confirme sa survenue : il ne s’agit que d’une simple accusation. Dès lors, la France aurait dû faire preuve de prudence, informer les autorités algériennes et éviter de se précipiter dans l’arrestation et les poursuites. En droit, la liberté est la règle et la privation de liberté l’exception, qui ne peut être imposée que par décision ou ordonnance judiciaire. Ce que la France a fait est donc contraire aux usages diplomatiques.
Quant à l’Algérie, elle a pris des mesures diplomatiques à l’encontre de 12 membres de la mission diplomatique française en Algérie, sans leur adresser d’accusations, et ce malgré les nombreuses violations antérieures commises par l’ambassade et les ambassadeurs, lesquelles avaient été rendues publiques en leur temps.
Certains affirment que le procureur général en France pourrait invoquer la loi antiterroriste, en arguant qu’il s’agit d’un régime d’exception non couvert par les Conventions de Vienne. Cette approche est-elle juridiquement fondée, sachant qu’il est théoriquement admis que les traités internationaux priment sur les lois nationales des États ?
Le mot terrorisme est un terme vague et fourre-tout, souvent utilisé par ceux qui manquent d’arguments solides. Avant même de formuler une accusation, il est impératif d’établir l’existence de l’« acte » en question. Or, dans notre cas, ce n’est pas l’accusation que nous contestons, mais bien la réalité même de l’acte reproché. Le côté français peut dire ce qu’il veut, mais la loi exige qu’il prouve l’acte attribué à la personne avant de pouvoir restreindre sa liberté.
Par conséquent, en l’absence de preuve, en raison de la violation des procédures de poursuite et du non-respect de l’obligation d’informer l’État d’origine de l’intéressé – comme le prévoit la Convention de 1963 sur les relations consulaires –, la procédure engagée par la justice française est considérée comme illégale.
Quant à la hiérarchie des normes, et donc à la supériorité des conventions internationales sur les lois nationales, ce que vous dites est exact. Toutefois, ce principe n’est pas le nœud du problème dans cette affaire. En effet, la convention exige d’abord que l’acte reproché à l’employé soit établi, avant même de pouvoir décider s’il y a lieu ou non d’appliquer la convention.
Cela dit, sur le plan procédural, nous sommes en présence d’une affaire judiciaire, et c’est dans un second temps, à l’issue de l’enquête, qu’il faudra déterminer si les faits relèvent ou non de la Convention ou du droit national français.
Quelle aurait été la procédure légale appropriée à suivre en cas de suspicion d’implication d’un membre d’une mission diplomatique dans des actes réprimés par la loi de l’État hôte ?
Il s’agissait de respecter la convention, en informant l’État d’origine de l’employé de l’incident. Si les faits étaient avérés et que l’arrestation avait eu lieu en dehors de ses fonctions officielles, l’État hôte pouvait le faire. Sinon, en l’absence de preuve, il aurait simplement dû être déclaré persona non grata.
Quelles sont les issues légales possibles dans cette situation ?
Actuellement, je vois deux voies possibles :La première est la voie judiciaire, menée par les avocats devant la justice française, conformément au Code de procédure pénale français.
La seconde est la voie diplomatique, car il est possible que les faits soient utilisés comme moyen de pression ou de marchandage, en lien avec l’arrestation, la poursuite et la condamnation de Boualem Sansal par les autorités judiciaires algériennes, et les appels pressants en faveur de sa libération. L’objectif pourrait être un échange entre les deux hommes. Mais il y a une grande différence entre les deux cas : Sansal est d’origine algérienne, a récemment acquis la nationalité française, et a commis des actes portant atteinte à la souveraineté nationale, entre autres.
Vous sous-entendez donc que l’affaire de l’employé consulaire a été politisée, détournée de son cadre diplomatique, et utilisée pour saboter le processus d’apaisement qui commençait à se dessiner entre les deux pays, notamment après l’appel téléphonique entre les présidents Tebboune et Macron, et les suites qui en ont découlé ?
Les présidents Tebboune et Macron partagent une volonté commune de résoudre les problèmes entre les deux pays dans tous les domaines, étant donné la sensibilité des sujets en jeu. Mais malheureusement, la France est confrontée à des conflits entre différents blocs politiques, partis et groupes de pression, qui luttent pour empêcher l’aboutissement du projet de réconciliation, les discussions sur la mémoire, la restitution des archives et d’autres dossiers.
Cette affaire serait, donc, l’un des reflets du conflit politique existant en France… Mais on dit que la justice en France est totalement indépendante et séparée du pouvoir politique ?
Relativement. Il y a eu de nombreuses affaires dans lesquelles la justice française n’a pas agi de manière indépendante. Parmi elles, l’affaire du militant palestinien George Habache. Bien que j’aie approuvé la décision au moment de son arrestation à Paris, c’est finalement une décision politique qui a permis sa libération, en dépit des décisions judiciaires.
L’accord de coopération judiciaire signé en 2021 a-t-il un rôle dans cette affaire ?
Cet accord remonte en réalité à 1963. Il couvre tous les aspects de la coopération judiciaire, bien entendu sous supervision judiciaire. Mais la France n’a jamais pu appliquer ses dispositions, comme en témoigne le fait que des dizaines de commissions rogatoires liées aux auteurs de détournements de fonds publics sont restées sans suite.

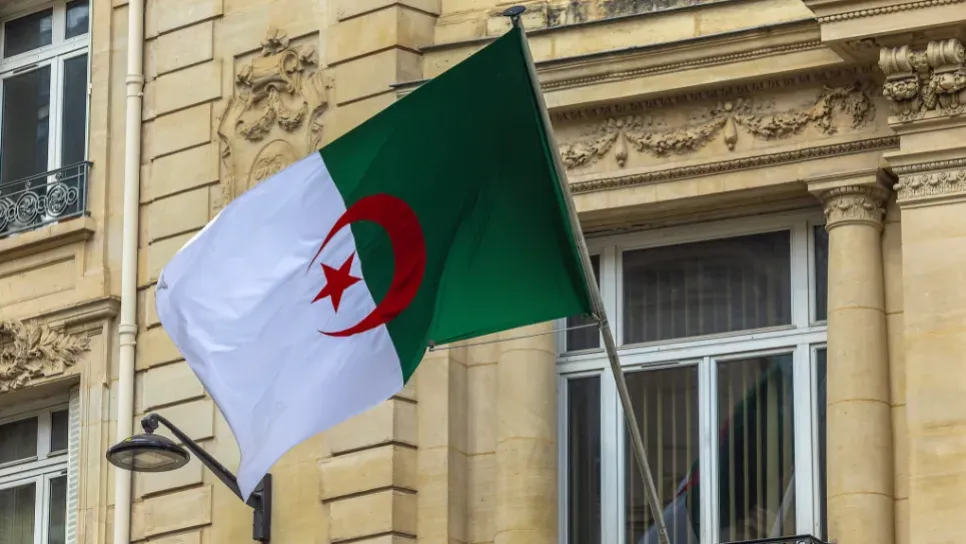






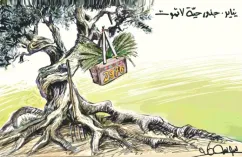
Commentaires
Participez Connectez-vous
Déconnexion
Les commentaires sont désactivés pour cet publication.