Les craintes d’un effondrement des institutions restantes en Libye refont surface, sur fond de conflits alimentés par des puissances régionales et internationales en quête d’influence et de ressources.
Depuis son entrée en scène via le groupe Wagner, la Russie s’est efforcée d’ancrer une présence stratégique en Libye, profitant du vide politique et de la division militaire entre l’Est et l’Ouest du pays. Dans le cadre de sa reconfiguration en Afrique, Moscou cherche désormais à établir un contrôle institutionnel direct, comme en témoigne l’accueil officiel accordé récemment au maréchal Khalifa Haftar et à son fils Saddam lors de leur visite à Moscou pour les célébrations du jour de la « Victoire ».
Ce positionnement reflète la volonté russe d’étendre son influence géopolitique, notamment dans l'Est libyen riche en pétrole, tout en sécurisant un accès permanent à la Méditerranée, connecté à un axe logistique stratégique s'étendant vers le Sahel. Dans ce jeu d’échecs mondial, la Libye devient un levier de pression contre l’Occident dans le cadre de négociations plus larges entre Moscou et les capitales occidentales.
L’intervention turque en Libye occidentale a intensifié la polarisation. Suite à un accord sécuritaire et maritime signé fin 2019 avec le Gouvernement d’union nationale (GNA), Ankara a déployé des troupes, des conseillers militaires et des drones armés pour repousser l’offensive de Haftar sur Tripoli. Ce soutien militaire n’a pas mis fin au conflit, mais a plutôt transformé la Libye en théâtre d’affrontements indirects entre puissances régionales, notamment les Émirats, l’Égypte et la France, qui soutiennent l’Est.
À partir de 2025, face à l’évolution du contexte régional, la Turquie a adopté une approche plus pragmatique en jouant le rôle de médiateur entre les factions libyennes. La visite de Saddam Haftar à Ankara en avril dernier, ponctuée par des rencontres de haut niveau, a abouti à des accords de formation militaire et de fourniture d’équipements, y compris des drones.
Ce changement de posture marque une volonté turque de renforcer son influence économique et diplomatique à travers la réduction des tensions internes, l’accès aux projets de reconstruction, et la consolidation de sa présence en Afrique du Nord — une ambition qui la met en concurrence directe avec la France et l’Égypte.
Les Émirats arabes unis : un rôle perturbateur assumé
Sur le plan régional, les Émirats arabes unis ont joué un rôle particulièrement perturbateur, en apportant un soutien militaire et politique massif aux forces de Haftar, en violation des résolutions internationales interdisant l’armement des parties libyennes. Ce soutien a été déterminant dans l’intensification du conflit : drones chinois "Wing Loong", blindés, systèmes de défense antiaérienne, livrés via des ponts aériens secrets documentés par l’ONU.
Sous prétexte de "lutte contre le terrorisme" et d’opposition à "l’islam politique", les Émirats ont en réalité contribué à l’attaque contre Tripoli en avril 2019, déclenchant une guerre civile meurtrière qui a duré près d’un an et demi, avec des milliers de victimes et d’importantes destructions.
En parallèle, Abu Dhabi a sapé les efforts diplomatiques internationaux en menant des campagnes politiques et médiatiques favorables à Haftar, le présentant comme un "homme de stabilité", malgré son rejet de la légitimité reconnue par l’ONU. Elle a aussi soutenu les blocs régionaux opposés à l’ancien gouvernement d’union, encourageant des solutions militaires au détriment du dialogue politique.
Ce comportement s’inscrit dans une ambition émiratie plus large : dominer l’Afrique du Nord et l’Est méditerranéen, en opposition stratégique à la Turquie et au Qatar. Des rapports ont accusé les Émirats de financer des opérations visant à saboter la transition démocratique libyenne et à empêcher l’émergence d’un modèle de gouvernance civile pouvant inspirer d’autres peuples arabes.
L’Europe et les États-Unis : entre intérêts divergents et prudence
L’attitude des pays européens face à la crise libyenne reste divisée. La France affiche un soutien discret à Haftar, notamment dans le sud libyen, au nom de la lutte contre les groupes armés, tout en prétendant soutenir un processus politique global. L’Italie, plus concernée par sa proximité géographique, se concentre sur les flux migratoires et la sécurité énergétique, en cherchant à maintenir de bonnes relations avec Tripoli pour garantir ses approvisionnements en gaz.
Les États-Unis adoptent, de leur côté, une posture de prudence. Bien que peu impliqués directement, Washington soutient les efforts de l’ONU pour unifier les institutions et organiser des élections. Néanmoins, les Américains gardent un œil attentif sur les avancées russes ou chinoises en Libye, particulièrement autour des ressources énergétiques et de la lutte contre le terrorisme.
Cet état des lieux souligne à quel point les luttes d’influence régionales et internationales empêchent la Libye de sortir de l’instabilité. Plus d’une décennie après la chute de Kadhafi, le pays reste prisonnier d’agendas étrangers, où le pétrole, la géopolitique et la stratégie militaire priment sur les aspirations populaires à la paix et à la souveraineté.
La solution doit être libyo-libyenne, comme le prône l’Algérie. Mais la réalité, est qu’aucun règlement durable ne pourra voir le jour sans une volonté internationale sincère de faire primer l’intérêt des Libyens sur les calculs géostratégiques, et de garantir l’unité et l’intégrité de la Libye.


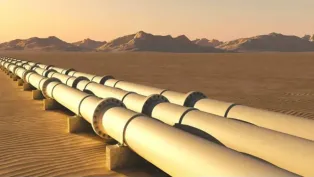






Commentaires
Participez Connectez-vous
Déconnexion
Les commentaires sont désactivés pour cet publication.